
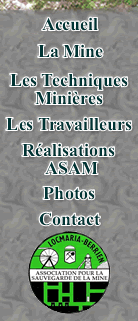
les travailleurs de la mine
| En plus des cadres, pratiquement tous étrangers jusqu'à la fin du XVIIIème siècle, dont on a déjà parlé, il y avait aussi, à la Mine, des ouvriers spécialisés, venant des régions minières françaises, comme Ste-Marie-Aux-Mines, St-Etienne,... Le reste était des journaliers ou manoeuvres, recrutés dans la campagne environnante. Ils constituaient les 9/10 des effectifs. Parmi eux, il y avait des femmes et des enfants (de 12 à 14 ans), affectés au lavage du minerai. |
Les conditions de travail
Elles étaient dures :
- journées longues : de 12 à 16 heures l'été, de 8 heures l'hiver
- insalubrité : les laveuses manipulaient le minerai dans une eau glaciale et corrosive.
- humidité et manque d'air dans les galeries
- maladies : dysenteries, provoquées par la pollution de l'eau; troubles pulmonaires dus à l'humidité au fond de la mine; tuberculose, typhoïde, typhus, saturnisme plus fréquent à Poullaouën à cause de la pollution pas volatilisation dans l'atmosphère de 10 % du plomb traité aux fonderies.
Les salaires
Ils n'étaient pas élevés, mais certains avantages sociaux étaient accordés au personnel. Le plus important était la "caisse de secours" ou "boîte des invalides" qui permettait d'octroyer aux ouvriers blessés des indemnités de convalescence, ainsi que des pensions aux invalides, veuves et orphelins. |
Il y avait aussi, à la mine, une école construite à Poullaouën en 1791, un médecin, une infirmerie et une cantine.
Bref, on ne peut nier qu'existait un certain paternalisme de la Compagnie.
Les conflits du travail
Il n'y a pas eu de véritables luttes ouvrières, car les journaliers bretons gardaient une mentalité essentiellement paysanne, et n'avaient donc pas de conscience ouvrière. Cependant, de réels conflits du travail éclataient parfois. On peut en relever 4 principaux au XVIIIème siècle.
Un en 1767, à Poullaouën : les laveuses se mirent en grève, car la Compagnie voulait baisser leurs salaires pour les aligner sur ceux de Locmaria. La grève dura 6 semaines et la Direction céda. Ce fut là, vraisemblablement, la première grève, en France, du monde ouvrier féminin.
2 autres grèves éclatèrent en 1776 : celle des mineurs qui refusèrent d'être éclairés dans les galeries par des lampes à huile, et celle des machinistes.
En 1793, il y eu un autre conflit relatif au paiement des ouvriers en assignats (papier-monnaie) instaurés par le gouvernement révolutionnaire.

